Historique de la ville
Depuis le Fg St Jacques……..(AD 1991©)
 Recluse, Ozerain et Verpant. Trois cours d’eau ceinturent l’éperon rocheux et baigne la « Montagne » . Sur les flancs et les côteaux , la vigne s’étale.
Recluse, Ozerain et Verpant. Trois cours d’eau ceinturent l’éperon rocheux et baigne la « Montagne » . Sur les flancs et les côteaux , la vigne s’étale.
Grande Rue……..(AD 1991©)
 …du reste, c’est ce que fît César qui s’installe là avec armes et bagages, en 52 avant J.C., au moment où il décide de mettre fin à la révolte de Vercingétorix et de ses hommes. Il fait construire camps, fortifications avec contrevallations, chicanes, le tout pour assiéger l’opidum d’Alésia, sur l’autre rive de l’Ozerain.
…du reste, c’est ce que fît César qui s’installe là avec armes et bagages, en 52 avant J.C., au moment où il décide de mettre fin à la révolte de Vercingétorix et de ses hommes. Il fait construire camps, fortifications avec contrevallations, chicanes, le tout pour assiéger l’opidum d’Alésia, sur l’autre rive de l’Ozerain.
Dès la période gallo-romaine « Flaviniacum » prend de l’importance, c’est le nom du lieu de Flavinius, propriétaire de cette terre. Les premières constructions du village datent de cette période : une « villa » à vocation agricole et artisanale, ainsi qu’un « castrum » dont il ne reste plus aujourd’hui de vestiges connus. 719, la terre passe sous domination burgonde directe : naissance de l’abbaye bénédictine St Pierre de Flavigny. (Restauration et remplacement d’une colonne Carolingienne)
755, l’abbé Manassès dit le Grand, avec son avènement, apporte le corps de St Prix évêque de Clermont au VIIè siècle. Manassès fait quelques aménagements pour accueillir l’insigne relique. Comme cela est de coutume durant cette période, les corps saints sont déposés dans des cryptes. Une première crypte a donc pu exister dès cette époque.
Toujours sous le règne de Manassès, l’abbaye grandit. On y observe la psalmodie perpétuelle comme à Luxeuil, Agaune ou St Bénigne de Dijon. Charlemagne dans des lettres datées de Thionville félicite Manassès qu’il apprécie.
Derrière l’Église St Genès…….(AD 1991©)
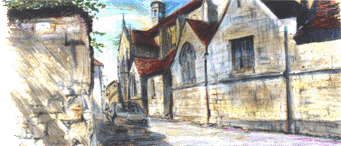
Avec les nouvelles modifications de l’abbatiale, les moines reçoivent le 22 mars 864, depuis Alise le transfère des reliques de Ste Reine, dans le but de les préserver de l’invasion Viking imminente. Elles seront déposées dans la « Prison de Ste Reine ». Sanctuaire à rotonde, c’est un élément d’importance pour la connaissance de l’architecture et l’archéologie médiévales.
878, la nouvelle abbatiale, construite sur le site de l’église primitive, est consacrée par le pape Jean VIII. À cette occasion les « moines bénédictins lui offre huit livres d’anis », selon la tradition et que rapportaient des manuscrits, aujourd’hui, disparus. Le dernier témoignage remontant à cette époque, demeure la » Foire de la St Simon » (qu’avec l’aide de quelques habitants, je réinventais en 1977).
11 janvier 887, les Vikings sont là, sous les murs de la Cité qu’ils assiègent jusqu’au 25 janvier, selon Hugues de Flavigny. Il y a huit tués parmi les moines ou serviteurs. Immédiatement l’abbaye est l’objet de plusieurs constructions successives, des vestiges sont toujours visibles. Lieu de pèlerinages renommé, avec le « culte des reliques », durant les périodes mérovingienne et carolingienne.
Vers 1085/1092 Rainald dévot de St Prix, effectue la translation des reliques dans une chasse ornée d’or, d’argent et de pierreries. C’est à cette même époque que les reliques de Ste Reine sont mises et déposées dans un reliquaire d’argent.
Dans une seconde crypte, seulement découverte en 1961, était déposé l’ensemble des reliques de l’Abbaye. Au rez de chaussée ne sont admis que des pèlerins privilégiés qui circulent librement autour des reliquaires. Ils peuvent les toucher, alors que le « vulgus » est relégué à l’étage où une galerie permet la déambulation des fidèles qui n’ont aucun contact physique avec les chasses.
11 janvier 887, les Vikings sont là, sous les murs de la Cité qu’ils assiègent jusqu’au 25 janvier, selon Hugues de Flavigny. Il y a huit tués parmi les moines ou serviteurs. Immédiatement l’abbaye est l’objet de plusieurs constructions successives, des vestiges sont toujours visibles. Lieu de pèlerinages renommé, avec le « culte des reliques », durant les périodes mérovingienne et carolingienne.
Rue de l’Église…..(AD 1991©) :

Vers 1085/1092 Rainald dévot de St Prix, effectue la translation des reliques dans une chasse ornée d’or, d’argent et de pierreries. C’est à cette même époque que les reliques de Ste Reine sont mises et déposées dans un reliquaire d’argent.
Dans une seconde crypte, seulement découverte en 1961, était déposé l’ensemble des reliques de l’Abbaye. Au rez de chaussée ne sont admis que des pèlerins privilégiés qui circulent librement autour des reliquaires. Ils peuvent les toucher, alors que le « vulgus » est relégué à l’étage où une galerie permet la déambulation des fidèles qui n’ont aucun contact physique avec les chasses.
Dès l’origine, Flavigny est le centre d’une région s’étendant sur un vaste territoire ( Dijon - Langres - Autun) . C’est une Seigneurie ecclésiastique, qui mettra en place et sa juridiction et son administration financière. Les abbés qui se succèdent à la tête de l’abbaye exercent à la fois pouvoir temporel et pouvoir politique qui, souvent prend le pas sur la mission religieuse.
Importante place de négoces, les seigneurs d’alentour y font bâtir leurs résidences, au plus près de leur suzerain… Y vivent aussi, et y travaillent, artisans et marchands d’où la richesse du patrimoine architectural civil dont témoigne encore le grand nombre des bâtiments érigés entre les XII et XVIIIè siècle.
Au Xè siècle le développement de la Cité est attesté par l’existence de l’église paroissiale St Genès. Le début de la construction d’une première enceinte fortifiée, par Renaud II seigneur abbé, permet d’assurer la protection de l’abbaye et de la ville qui l’entoure, autre preuve de prospérité de la Ville. Le chantier dure jusqu’au XIIIè siècle, période d’érection de la partie interne de l’actuelle Porte du Val qui sera, longtemps, l’entrée principale de la ville. Puis c’est la construction d’une nef gothique pour l’abbaye, dont quelques vestiges attestent de la qualité du bâti. Le XIIIè siècle est faste pour l’ensemble des citadins : reconstruction de l’église St Genès, complétée au XVè siècle par une étonnante tribune avec sa chaire en cul-de-lampe, construction du chœur et installation de stalles finement sculptées, destinées à la « Confrérie des Messieurs de St Genès », « L’Ange de l’Annonciation » chef d’œuvre daté de cette époque.
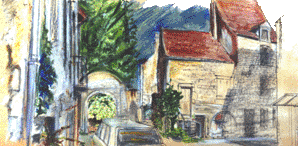 … La Maison des Arts Textiles & du Design, musée textile de l’Auxois
… La Maison des Arts Textiles & du Design, musée textile de l’Auxois
est installée dans l’ancienne Conciergerie du Logis Abbatiale et mon atelier occupe l’ancienne Maison de Justice, au-dessus des Prisons…
Dans le même temps, nobles et bourgeois se font bâtir de fastueuses demeures tel le Logis du Grand Bailli d’Auxois qui en 1848 deviendra le noviciat des Frères Prêcheurs fondé par le dominicain Lacordaire.
Angle des rues Voltaire et Lacordaire….(AD 1991©)
Les XIVè et XVè siècles voient se poursuivre les travaux de fortification et de construction : la Porte du Bourg et son pont-levis sont bâtis mi XVè, les demeures avec tourelle d’escalier en pierre de taille en sont le témoignage, la ville est en expansion jusqu’à la Renaissance. Pendant les guerres de religions, Flavigny joue un rôle particulier. Henri III y établit, entre 1589 et 1592 le Parlement loyaliste de Bourgogne en opposition totale au Parlement ligueur de Dijon.
Au XVIIè le calme revient et avec lui l’installation en 1632 d’Ursulines venues de Langres. Elles ouvrent une école pour jeunes filles. 1700 les religieuses se lancent dans la construction d’un nouveau couvent, en 1720 la construction jugée trop ambitieuse est abandonnée sur ordre de la hiérarchie ecclésiastique. On peut toujours juger du projet avant l’arrêt des travaux, dans ce qu’il reste des bâtiments aujourd’hui.
Maison au Loup……..(AD 1991©) :

Durant cette période Claude Coutier marquis de Souhey, gouverneur de Flavigny se fait bâtir un magnifique hôtel au dessus des terrasses superposées dominant la vallée du Verpant. L’abbé commendataire fait remanier la façade du Logis Abbatiale dans le goût du temps et crée porche et terrasses dominant le val de la Recluse. L’abbaye n’échappe pas à d’importants aménagements, témoin : l’aile XVIIIè toujours existante.
Rue du Centre….(AD 1991©)
 Flavigny fourmille d’une population nombreuse et active, on croise tout au long de son lacis de rues, ruelles et places non seulement tanneurs, huiliers, minotiers, potiers d’étain, tailleurs de pierre, verriers, tisserands mais aussi notaires, avocats, médecins, apothicaires et autres bourgeois, sans oublier les vignerons, les paysans ou le monde ecclésiastique. À la Révolution, l’ensemble des bâtiments conventuels sont vendus comme biens nationaux. Ils sont achetés par des particuliers et des entrepreneurs qui s’en servent quelques fois comme carrière de pierres.
Flavigny fourmille d’une population nombreuse et active, on croise tout au long de son lacis de rues, ruelles et places non seulement tanneurs, huiliers, minotiers, potiers d’étain, tailleurs de pierre, verriers, tisserands mais aussi notaires, avocats, médecins, apothicaires et autres bourgeois, sans oublier les vignerons, les paysans ou le monde ecclésiastique. À la Révolution, l’ensemble des bâtiments conventuels sont vendus comme biens nationaux. Ils sont achetés par des particuliers et des entrepreneurs qui s’en servent quelques fois comme carrière de pierres.
Au XIXè, prospère cité vigneronne, Flavigny devient Chef-lieu de Canton avec gendarmerie, justice de paix, perception, marchés et foires y fleurissent régulièrement. En 1848, le Père Lacordaire s’y installe avec son noviciat. En 1863, premier bourg de la région à être desservi en eau courante, l’électricité suivra bientôt avec la turbine du Moulin Chantrier.
Avec la fin du XIXè siècle, la population décroît lentement mais inexorablement. Le phylloxera arrête net l’exploitation du vignoble remplacé par près et champs. La construction et le passage du PLM aux Laumes accentue le déclin de la cité. Les deux guerres mondiales y prélèvent leur tribut en homme et en vie humaine. Après la « Libération » la gendarmerie, la justice de paix, les symboles du chef lieu, sont transférés à Venarey les Laumes, déplaçant ainsi la tradition d’échanges vers la plaine…

La Boulangerie….(AD 1991©)
… Depuis quelques années maintenant, le phénomène s’inverse. Une population jeune s’installe de nouveau, et avec des naissances et des activités nouvelles …
FIN temporaire,
à suivre…

